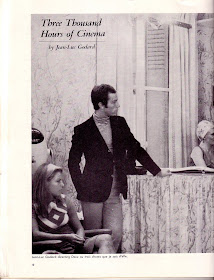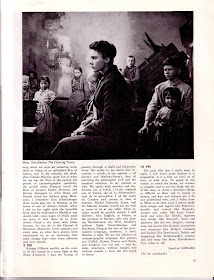Filmar o mundo como um ato de amor.
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
sábado, 18 de dezembro de 2010
Elsewhere
I don't give a fuck about the merry-go-round decorated by Walt Disney, the lunch on the grass with imitation plastic clothes, the chewing-gum green of a ball of wool. I don't give a fuck about any of the lapses in taste piled up by Astruc, Claude Renoir and Mayo. Or about Roman Vlad's saxophone either. Which actually isn't bad. But anyhow, the real beauty of Une vie lies elsewhere.
In Pascale Petit's yellow dress shimmering amid the Velazquez grey dunes of Normandy. That's wrong! Not Velasquez grey? Not even Delacroix grey, howl the connoisseurs.
To no purpose. Already Christian Marquand is leaning over the break-water, holding out his hand to Maria Schell. The 'connoisseurs' are thrown by a film that moves so quickly like the fastest racing cars are those that brake best: Une vie is like them. One thought one knew Astruc, and constructed theories without noticing that the sequence was over and had already taken off in another aesthetic or moral direction. One talked of Velasquez without noticing that Pascale Petit's dress was Baudelaire yellow, and Maria Schell's eyes Ramuz blue. Why Ramuz? Because behind Maupassant's puppets, behind Jeanne and Julien, it is the face of Aline or Jean-Luc persecuted that Astruc is filming. There is nothing surprising about this. His admiration for the author of Les signes parmi nous has long been known. But why a moment ago the author of L'albatros? Because the first shot of Une vie stamps the whole film with Baudelarian effigy. Because Maria Schell runs headlong towards the sea and Pascale's dress is like an echo illustrating the most celebrated verses of the man who said to Manet, 'You are supreme in the decadence of your art.' One might mention Thomas Hardy, as well as Faulkner and the Charlotte Rittenmayer of The Wild Palms, here transposed into the character played by Marquand; but Astruc himself has already talked of them so much - too much - that the admirers of Le rideau are now looking for difficulties and being surprised to find none. All of which proves what? That people talked of painting without noticing that Une vie was a novelist's film; and of taste without noticing that it is a barbarian's film.
My defense of the film against those who admire it for the wrong reasons is now done. Against the rest, the task is easier, for Une vie is almost the opposite of an Astruc film in the sense that he has been labelled with a prefabricated aesthetic form from which he is now escaping.
It is of no consequence that the version now showing in cinemas does not correspond to the one envisaged in the scenario. It is of no consequence that the montage has systematically cut off each scene in mid flow. One may admire Une vie as it stands. And as it stands Une vie is the opposite of an inspired film. The madness behind the realism, said Astruc in an interview. But this has been misunderstood. Julien's madness lies in having married Jeanne, and Jeanne's in having married Julien. Full stop and finish. He was not trying to film La folie du docteur Tube, but to show that for a man of wood and a woman of soul to marry is madness. As a matter of fact, Une vie disconcerts Astruc's keenest partisans, just as Le plaisir disconcerted those who thought they knew Maupassant. Where they expected Astruc the lyricist, they found Astruc the architect.
Une vie is a superbly constructed film. So, to illustrate my point, I shall borrow images from classical geometry. A film may be compared to a geometrical locus; that is, a figure constituted by all points which satisfy a particular equation of relation to a fixed element. This ensemble of points is, if you like, the mise en scène, and this particular equation common to each moment of the mise en scène will, therefore, be the scenario, or if you prefer, the dramatic situation. There remains the fixed element, or possible mobile one, which is none other than the theme. But the following thing happens. With most directors, the geometrical locus of the theme they are supposed to be dealing with extends no further than the situation where it is filmed. What I mean is that although the action of their films may take place over a vast area, most directors do not think their mise en scène beyond the area of the set. Astruc, on the other hand, gives the impression of having thought his film over the whole perimeter required by the action - no more, no less. In Une vie, we are only shown three or four landscapes in Normandy. Yet the film gives an uncanny feeling of having been planned on the actual scale of Normandy, just as Tabu was for the Pacific, or Que Viva Mexico! for Mexico. The references may be exaggerated. But they are there. The fact is too remarkable not to be pointed out, and it is all the more remarkable in that Astruc and Laudenbach have deliberately made difficulties for themselves by only showing, as I have just noed, three or four aspects of the Norman woodlands. The difficulty is not in showing the forest, but in showing a room where one knows that the forest is a few paces away; an even greater difficulty is, not in showing the sea, but a room where one knows the sea is a few hundred yards away. Most films are constructed over a few square feet of décor visible in a viewfinder. Une vie is conceived, written and directed over twenty thousand kilometers.
Over this immense invisible space, Astruc has established his dramatic and visual co-ordinates. Between the abscissa and the ordinate no curve appears which might correspond to a secret movement of the film. The only curve is either abscissa or ordinate, and therefore corresponds the two kinds of movement, one horizontal, the other vertical. The whole mise en scène of Une vie is based on this elementary principle. Horizontal, Maria Schell and Pascale Petit running towards the beach. Vertical, Marquand bending to take his partner's hand on the harbour jetty. Horizontal, the bridal couple leaving after the wedding banquet. Vertical, the knife stroke which rips open the bodice. Horizontal again, the movement of Jeanne and Julien sprawling in the wheatfield. Vertical again, the movement of Marquand's hand seizing Antonella Lualdi's wrists. For Astruc, the mise en scène of Une vie has simply meant emphasizig one of these two movements, horizontal and vertical, in each scene or each shot having its own dramatic unity, and emphasizing it abruptly, so that everything before or after it which does not form part of this abrupt motion is left in shadow.
In Les mauvaises rencontres Astruc was still using this sort of effects, this premeditated violence, in the manner of Bardem: as a shot changed, a door opened, a glass shattered, a face turned. In Une vie, on the other hand, he uses it within a shot, pushing the example of Brooks - or, more especially, Nicholas Ray - so far that the effect becomes almost the cause. The beauty is not so much Marquand dragging Maria Schell out of the chateau as in the abruptness with which he does it. This abruptness of gesture which gives a fresh impulse to the suspense every few minutes, this discontinuity latent in its continuity, might be called the tell-tale heart of Une vie, to show the kinship of the so-called 'cold' film with Edgar Poe, the true master of mystery and the most abstract writer of all.
Une vie is a wonderfully simple film, exactly like Bitter Victory. And simplification does not mean stylization. Astruc is very different here from Visconti, with whom it would be silly to compare him. Certainly Maria Schell was more effectively used in White Nights; but in Une vie she is used more accurately and profoundly. In his time, Maupassant was doubtless a modern writer. Paradoxically, therefore, the best way of capturing the true nineteenth-century atmosphere was to give the whole thing a frankly 1958 atmosphere. In this Astruc and Laudenbach have succeeded magnificently. As proof, I need only cite the admirable line spoken by the admirable Christian Marquand to the woman who has offered him her dowry and her chateau: 'Because of you, I have ruined my life.' Another example: whereas Jean-Claude Pascal carrying Anouk Aimée seemed old-fashioned (in Les mauvaises rencontres), here the same gesture with Marquand and Maria Schell seems modern.
Once one has raved about Pascale Petit (with whom Astruc has worked as much of a miracle as Renoir with Françoise Arnoul in French Cancan), who runs through the forest as gracefully as Orvet and hides under the bedclothes better than Vadim's girls, one has not said it all. The threshold of the unknown: this might be a better title for Une vie than for a science-fiction film. For Une vie forces the cinema to turn its gaze elsewhere.
Jean-Luc GODARD
Cahiers du Cinéma nº 89, novembro 1958, pp. 50-53
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
O Mac-Mahon apresenta...
Anáguas a Bordo (Blake Edwards, 1959)
Anatomia de um Crime (Otto Preminger, 1959)
Armadilha a Sangue Frio (Joseph Losey, 1960)
Assassinato S.A. (Burt Balaban & Stuart Rosenberg, 1960)
O Assassino Público nº 1 (Don Siegel, 1957)
Audazes e Malditos (John Ford, 1960)
Beijos que Não se Esquecem (Walter Lang, 1959)
Bem no Meu Coração (Stanley Donen, 1954)
Boneca de Carne (Elia Kazan, 1956)
Brotinho Indócil (Vincente Minnelli, 1958)
Casa, Comida e Carinho (Charles Walters, 1950)
Um Certo Capitão Lockhart (Anthony Mann, 1955)
Colinas da Ira (Robert Aldrich, 1959)
Os Corruptos (Fritz Lang, 1953)
De Folga para Amar (Blake Edwards, 1958)
A Descarada (Raoul Walsh, 1956)
O Diabo Feito Mulher (Fritz Lang, 1952)
Dizem que é Amor (Blake Edwards, 1960)
Dizem que é Pecado (Joseph L. Mankiewicz, 1951)
Duelo de Paixões (Henry King, 1955)
Duelo de Titãs (John Sturges, 1959)
Elas Querem é Casar (Charles Walters, 1959)
Encontro com a Morte (Joseph Losey, 1959)
A Encruzilhada dos Destinos (George Cukor, 1956)
Entre Deus e o Pecado (Richard Brooks, 1960)
Esse Homem é Meu (Raoul Walsh, 1956)
Esther e o Rei (Raoul Walsh, 1960)
Um Estranho no Paraíso (Vincente Minnelli, 1955)
Famintas de Amor (Robert Wise, 1957)
A Fera do Forte Bravo (John Sturges, 1953)
Frontier Rangers (Jacques Tourneur, 1959)
A Fúria do Desejo (King Vidor, 1952)
Fúria no Alasca (Henry Hathaway, 1960)
Gata em Teto de Zinco Quente (Richard Brooks, 1958)
O Gaúcho (Jacques Tourneur, 1952)
Hércules na Conquista da Atlântida (Vittorio Cottafavi, 1961)
Homem sem Rumo (King Vidor, 1955)
Honra a um Homem Mau (Robert Wise, 1956)
Irmão Contra Irmão (Robert Parrish & John Sturges, 1958)
Jejum de Amor (Richard Quine, 1955)
Julie (Andrew L. Stone, 1956)
O Maior Espetáculo da Terra (Cecil B. DeMille, 1952)
Meus Dois Carinhos (George Sidney, 1957)
Os Mil Olhos do Dr. Mabuse (Fritz Lang, 1960)
O Moço da Filadélfia (Vincent Sherman, 1959)
O Monstro de Londres (Joseph Losey, 1954)
Mortos que Caminham (Samuel Fuller, 1962)
O Mundo é das Mulheres (Jean Negulesco, 1954)
Nas Garras da Ambição (Raoul Walsh, 1955)
Nasce uma Estrela (George Cukor, 1954)
A Nave da Revolta (Edward Dmytryk, 1954)
No Labirinto do Vício (John Frankenheimer, 1957)
O Nono Mandamento (Richard Quine, 1960)
Nunca aos Domingos (Jules Dassin, 1960)
Onde Começa o Inferno (Howard Hawks, 1959)
Paixões Desenfreadas (Mark Robson, 1960)
Palavras ao Vento (Douglas Sirk, 1956)
A Passagem da Noite (James Neilson & Anthony Mann, 1957)
Um Pecado em Cada Alma (Rudolph Maté, 1955)
Pelo Sangue de Nossos Irmãos (Jacques Tourneur, 1956)
O Preço de um Homem (Anthony Mann, 1953)
Prisioneiros da Mongólia (Robert Wise, 1953)
Procura-se uma Estrela (Stanley Donen, 1953)
Punido pelo Próprio Sangue (John Sturges, 1956)
A Quadrilha Maldita (André De Toth, 1959)
Qual Será o Nosso Amanhã? (Raoul Walsh, 1955)
Quanto Mais Quente Melhor (Billy Wilder, 1959)
Raposas do Espaço (Dick Powell, 1958)
Rapsódia (Charles Vidor, 1954)
Recrutas e Enxutas (Raoul Walsh, 1959)
Região do Ódio (Anthony Mann, 1954)
O Rei dos Facínoras (Budd Boetticher, 1960)
O Rio das Almas Perdidas (Otto Preminger, 1954)
Um Rosto na Multidão (Elia Kazan, 1957)
Se Meu Apartamento Falasse (Billy Wilder, 1960)
Sete Homens e um Destino (John Sturges, 1960)
O Sétimo Pecado (Ronald Neame & Vincente Minnelli, 1957)
Sindicato de Vigaristas (Charles F. Haas, 1959)
Suplício de uma Alma (Fritz Lang, 1956)
O Terceiro Homem (Carol Reed, 1949)
Terra dos Faraós (Howard Hawks, 1955)
Terra Maravilhosa (Robert Parrish, 1959)
O Tesouro do Barba Rubra (Fritz Lang, 1955)
Testemunha de Acusação (Billy Wilder, 1957)
O Tigre de Bengala/O Sepulcro Indiano (Fritz Lang, 1959)
Travessuras de Casados (Edmund Goulding, 1952)
A Última Caçada (Richard Brooks, 1956)
O Vale das Paixões (Henry King, 1959)
A Verdade Dói (John Guillermin, 1958)
A Vergonha de Ser Profana (John Farrow, 1957)
Uma Viúva em Trinidad (Vincent Sherman, 1952)
Viva Las Vegas (Roy Rowland, 1956)
sábado, 20 de novembro de 2010
"QU'EST-CE QUE L'ART, JEAN-LUC GODARD ?"
par Louis Aragon. Qu'est-ce que l'art ? Je suis aux prises de cette interrogation depuis que j'ai vu le Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, où le Sphinx Belmondo pose à un producer américain la question : Qu'est-ce que le cinéma. Il y a une chose dont je suis sûr, aussi, puis-je commencer tout ceci devant moi qui m'effraye par une assertion, au moins, comme un pilotis solide au milieu des marais : c'est que l'art d'aujourd'hui c'est Jean-Luc Godard. C'est peut-être pourquoi ses films, et particulièrement ce film, soulèvent l'injure et le mépris, et l'on se permet avec eux ce qu'on oserait jamais dire d'une production commerciale courante, on se permet avec leur auteur les mots qui dépassent la critique, on s'en prend à l'homme. L'Américain, dans Pierrot, dit du cinéma ce qu'il pourrait dire de la guerre du Vietnam, ou plus généralement de la guerre. Et cela sonne drôlement dans le contexte - l'extraordinaire moment du film où Belmondo et Anna Karina, pour faire leur matérielle, jouent devant une couple d'Américains et leurs matelots, quelque part sur la Côte, une pièce improvisée où lui est le neveu de l'oncle Sam et elle la nièce de l'oncle Ho... But it's damn good, damn good ! jubile le matelot à barbe rousse... parce que c'est un film en couleur, imaginez-vous. Je ne vais pas vous le raconter, comme tout le monde, ceci n'est pas un compte rendu. D'ailleurs ce film défie le compte rendu. Allez compter les petits sous d'un milliard ! Qu'est-ce que j'aurais dit, moi, si Belmondo ou Godard, m'avait demandé : Qu'est-ce que le cinéma ? J'aurais pris autrement la chose, par les personnes. Le cinéma, pour moi, cela a été d'abord Charlot, puis Renoir, Bunuel, et c'est aujourd'hui Godard. Voilà, c'est simple. On me dira que j'oublie Eisenstein et Antonioni. Vous vous trompez : je ne les oublie pas. Ni quelques autres. Mais ma question n'est pas du cinéma : elle est de l'art. Alors il faudrait répondre de même, d'un autre art, un art avec un autre, un long passé, pour le résumer à ce qu'il est devenu pour nous : je veux dire dans les temps modernes, un art moderne, la peinture par exemple. Pour le résumer par les personnes. La peinture au sens moderne, commence avec Géricault, Delacroix, Courbet, Manet. Puis son nom est multitude. A cause de ceux-là, à partir d'eux, contre eux, au-delà d'eux. Une floraison comme on n'en avait pas vue depuis l'Italie de la Renaissance. Pour se résumer entièrement dans un homme nommé Picasso. Ce qui, pour l'instant, me travaille, c'est ce temps des pionniers, par quoi on peut encore comparer le jeune cinéma à la peinture. Le jeu de dire qui est Renoir, qui est Bunuel, ne m'amuse pas. Mais Godard c'est Delacroix. D'abord par comment on l'accueille. A Venise, paraît-il. Je n'ai pas été à Venise, je ne fais pas partie des jurys qui distribuent les palmes et les oscars. J'ai vu, je me suis trouvé voir Pierrot le fou, c'est tout. Je ne parlerai pas des critiques. Qu'ils se déshonorent tout seuls ! Je ne vais pas les contredire. Il y en a pourtant qui ont été pris par la grandeur : Yvonne Baby, Chazal, Chapier, Cournot... Tout de même, je ne peux pas laisser passer comme ça l'extraordinaire article de Michel Cournot : non pas tant pour ce qu'il dit, un peu trop uniquement halluciné des reflets de la vie personnelle dans le film parce qu'il est comme tous, intoxiqué du cinéma vérité, et que moi je tiens pour le cinéma-mensonge. Mais, du moins, à la bonne heure ! voilà un homme qui perd pied quand il aime quelque chose. Et puis il sait écrire, excusez-moi, mais s'il n'en reste qu'un, à moi, ça m'importe. J'aime le langage, le merveilleux langage, le délire du langage : rien n'est plus rare que le langage de la passion, dans ce monde où nous vivons avec la peur d'être pris sans verd, qui remonte, faut croire, à la sortie de l'Eden, quand Adam et Eve s'aperçoivent nus avant l'invention de la feuille de vigne. Qu'est-ce que je raconte ? Ah ! oui j'aime le langage et c'est pour ça que j'aime Godard qui est tout langage. Non, ce n'est pas ça que je disais : je disais qu'on l'accueille comme Delacroix. Au salon de 1827, ce qui vaut bien Venise, Eugène, il avait accroché La mort de Sardanapale, qu'il appelait son Massacre n° 2 car c'était un peintre de massacres, et non un peintre de batailles, lui aussi. Il avait eu, dit-il, de nombreuses tribulations avec MM les très durs membres du jury. Quand il la voit au mur (ma croûte est placée le mieux du monde), à côté des tableaux des autres, cela lui fait, dit-il, l'effet d'une première représentation où tout le monde sifflerait. Cela avant que ça ait commencé. Un mois plus tard, il écrit à son ami Soulier : Je suis ennuyé de tout ce Salon. Ils finiront par me persuader que j'ai fait un véritable fiasco ! Cependant, je n'en suis pas encore convaincu. Les uns disent que c'est une chute complète que La mort de Sardanapale est celle des romantiques, puisque romantiques il y a ; les autres comme ça, que je suis inganno, mais qu'ils aimeraient mieux se tromper ainsi, que d'avoir raison comme mille autres qui ont raison si on veut et qui sont damnables au nom de l'âme et de l'imagination. Donc je dis que ce sont tous des imbéciles, que ce tableau a des qualités et des défauts, et que s'il y a des choses que je désirerais mieux, il y en a pas mal d'autres que je m'estime heureux d'avoir faites et que je leur souhaite. Le Globe, c'est-à-dire M. Vitet, dit que quand un soldat imprudent tire sur ses amis comme sur ses ennemis, il faut le mettre hors les rangs. Il engage ce qu'il appelle la jeune Ecole à renoncer à toute alliance avec une perfide dépendance. Tant il y a que ceux qui me volent et vivent de ma substance crieraient haro plus fort que les autres. Tout cela fait pitié et ne mérite pas qu'on s'y arrête un moment qu'en ce que cela va droit à compromettre les intérêts tout matériels, c'est-à-dire the cash (l'argent)... Rien ni le franglais n'a beaucoup changé depuis cent trente-huit ans. Il se trouve que j'avais été revoir La mort de Sardanapale il y a peu de temps. Quel tableau que ce "massacre" ! Personnellement, je le préfère de beaucoup à La liberté sur les barricades dont on me casse les pieds. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ce que l'art de Delacroix ici ressemble à l'art de Godard dans Pierrot le fou. Ca ne vous saute pas aux yeux ? Je parle pour ceux qui ont vu le film. Cela ne leur saute pas aux yeux. Pendant que j'assistais à la projection de Pierrot, j'avais oublié ce qu'il faut, paraît-il dire et penser de Godard. Qu'il a des tics, qu'il cite celui-ci et celui-ci là, qu'il nous fait la leçon, qu'il se croit ceci ou cela... enfin qu'il est insupportable, bavard, moralisateur (ou immoralisateur) : je ne voyais qu'une chose, une seule, et c'est que c'était beau. D'une beauté surhumaine. Physique jusque dans l'âme et l'imagination. Ce qu'on voit pendant deux heures est de cette beauté qui se suffit mal du mot beauté pour se définir : il faudrait dire de ce défilé d'images qu'il est, qu'elles sont simplement sublimes. Mais le lecteur d'aujourd'hui supporte mal le superlatif. Tant pis. je pense de ce film qu'il est d'une beauté sublime. C'est un mot qu'on emploie plus que pour les actrices et encore dans le langage des coulisses. Tant pis. Constamment d'une beauté sublime. Remarquez que je déteste les adjectifs. C'est donc comme Sardanapale, un film en couleur. Au grand écran. Qui se distingue de tous les films en couleur par ce fait que l'emploi d'un moyen chez Godard a toujours un but, et comporte presque constamment sa critique. Il ne s'agit pas seulement du fait que c'est bien photographié, que les couleurs sont belles... C'est très bien photographié, les couleurs sont très belles. Il s'agit d'autre chose. Les couleurs sont celles du monde tel qu'il est, comment est-ce dit ? Il faudrait avoir bien retenu : Comme la vie est affreuse ! mais elle est toujours belle. Si c'est avec d'autres mots, cela revient au même. Mais Godard ne se suffit pas du monde tel qu'il est : par exemple, soudain, la vue est monochrome, toute rouge ou toute bleue comme pendant cette soirée mondaine, au début, qui est probablement le point de départ de l'irritation pour une certaine critique (ça me rappelle cette soirée aux Champs Elysées, à la première d'un ballet d'Elsa, musique de Jean Rivier, chorégraphie de Boris Kochno, décors de Brassaï, le réparateur de radios, avec le déchaînement de la salle, les sifflets à roulettes parce que l'on voyait danser les gens du monde dans une boîte de nuit, et qu'est-ce que vous voulez tout de suite, Tout Paris se sentait visé ! Pendant cette soirée-ci, le renoncement au polychromisme sans retour au blanc et noir signifie la réflexion de J.L. Godard en même temps sur le monde où il introduit Belmondo et sa réflexion technique sur ses moyens d'expression. D'autant que cela est presque immédiatement suivi d'un effet de couleur qui s'enchaîne sur une sorte de feu d'artifice, des éclatements de lumière qui vont se poursuivre sans justification possible dans le Paris nocturne où s'enflamme la passion du héros pour Anna Karina, sous la forme arbitraire de pastilles, de lunes colorées qui traversent en pluie le pare-brise de leur voiture, qui grêlent leur visage et leur vie d'un arbitraire comme un démenti au monde, comme l'entrée de l'arbitraire délibéré dans leur vie. La couleur, pour J. L. G, ça ne peut pas n'être que la possibilité de nous faire savoir si une fille a les yeux bleus ou de situer un monsieur par sa Légion d'honneur. Forcément, un film de lui qui a les possibilités de la couleur va nous montrer quelque chose qu'il était impossible de faire voir avec le noir et blanc, une sorte de voix qui ne peut retentir dans le muet de couleurs. Dans la palette de Delacroix, les rouges, vermillon, rouge de Venise et laque rouge de Rome ou garance, jouant avec le blanc, le cobalt et le cadmium, est-ce de ma part une sorte particulière de daltonisme ? éclipsent pour moi les autres teintes, comme si celles-ci n'étaient mises là qu'afin d'être le fond de ceux-là. Ou faut-il rappeler le mot du peintre à Philarète Chasles, touchant Musset : C'est un poète qui n'a pas de couleur...etc. Moi, j'aime mieux les plaies béantes et la couleur vive du sang... Cette phrase qui m'est toujours restée me revenait naturellement à voir Pierrot le fou. Pas seulement pour le sang. Le rouge y chante comme une obsession. Comme chez Renoir, dont une maison provençale avec ses terrasses rappelle ici les Terrasses à Cagnes. Comme une dominante du monde moderne. A tel point qu'à la sortie je ne voyais rien d'autre de Paris que les rouges : disques de sens unique, Yeux multiples de l'on ne passe pas, filles en pantalons de cochenille, boutiques garance, autos écarlates, minium multiplié aux balcons des ravalements, carthame tendre des lèvres et des paroles du film, il ne me restait dans la mémoire que cette phrase que Godard a mise dans la bouche de Pierrot : Je ne peux pas voir le sang, mais qui, selon Godard, est de Federico Garcia Lorca, où ? qu'importe, par exemple dans La plainte pour la mort d'Ignacio Sanchez Mejias, je ne peux pas voir le sang, je ne peux pas voir, je ne peux, je ne. Tout le film n'est que cet immense sanglot, de ne pouvoir, de ne pas supporter voir, et de répandre, de devoir répandre le sang. Un sang garance, écarlate, vermillon, carmin, que sais-je ? Le sang des Massacres de Scio, le sang de La mort de Sardanapale, le sang de Juillet 1830, le sang de leurs enfants que vont répandre les trois Médée furieuse, celle de 1838 et celles de 1859 et 1862, tout le sang dont se barbouillent les lions et les tigres dans leurs combats avec les chevaux... Jamais il n'a tant coulé de sang à l'écran, de sang rouge, depuis le premier mort dans la chambre d'Anna-Marianne jusqu'au sien, jamais il n'y a eu à l'écran de sang aussi voyant que celui de l'accident d'auto, du nain tué avec des ciseaux et je ne sais plus, je ne peux pas voir le sang, Que ne quiero verla ! Et ce n'est pas Lorca mais la radio qui annonce froidement cent quinze maquisards tués au Vietnam... Là, c'est Marianne qui élève la voix : C'est pénible, hein, ce que c'est anonyme... On dit cent quinze maquisards, et ça n'évoque rien, alors que pourtant, chacun, c'étaient des hommes, et on ne sait pas qui c'est : s'ils aiment une femme, s'ils ont des enfants, s'ils aiment mieux aller au cinéma ou au théâtre. On ne sait rien. On dit juste cent quinze tués. C'est comme la photographie, ça m'a toujours fasciné... Ce sang qu'on ne voit pas, la couleur. On dirait que tout s'ordonne autour de cette couleur, merveilleusement. Car personne ne sait mieux que Godard peindre l'ordre du désordre. Toujours. Dans Les carabiniers, Vivre sa vie, Bande à part, ici. Le désordre de notre monde est sa matière, à l'issue des villes modernes, luisantes de néon et de formica, dans les quartiers suburbains ou les arrière-cours, ce que personne ne voit jamais avec les yeux de l'art, les poutrelles tordues, les machines rouillées, les déchets, les boîtes de conserves, des filins d'acier, tout ce bidonville de notre vie sans quoi nous ne pourrions vivre, mais que nous nous arrangeons pour ne pas voir. Et de cela comme de l'accident et du meurtre il fait la beauté. L'ordre de ce qui ne peut en avoir, par définition. Et quand les amants jetés dans une confuse et tragique aventure ont fait disparaître leurs traces, avec leur auto explosée aux côtés d'une voiture accidentée, ils traversent la France du nord au sud, et il semble que pour effacer leurs pas, il leur faille encore, toujours, marcher dans l'eau, pour traverser ce fleuve qui pourrait être la Loire... plus tard dans ce lieu perdu de la Méditerranée où, tandis que Belmondo se met à écrire, Anna Karina se promène avec une rage désespérée d'un bout à l'autre de l'écran en répétant cette phrase comme un chant funèbre : Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire... Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire... A propos de la Loire... Ce fleuve au moins, avec ses îlots et ses sables, j'ai pensé en le regardant que c'est celui qui passe dans le paysage à l'arrière de la Nature morte aux homards qui est au Louvre, que Delacroix a peinte, dit-on, à Beffes, dans le Cher près de la Charité-sur-Loire. Cet étrange arrangement (ou désordre) d'un lièvre, d'un faisan avec deux homards cuits vermillon sur le filet d'un carnier de chasse et un fusil devant le vaste paysage avec le fleuve et ses îles, on peut m'expliquer qu'il l'a fait pour un général habitant le Berry, il n'en demeure pas moins un singulier carnage, ce Massacre n° 2 bis, qui est à peu près contemporain de La mort de Sardanapale, et paraîtra aux côtés de ce tableau au Salon de 1827. C'était l'essai d'une technique nouvelle où la couleur est mélangée avec du vernis au copal. Toute la nature de Pierrot le fou est ainsi vernie avec je ne sais quel copal de 1965, qui fait que c'est comme pour la première fois que nous la voyons. Le certain est qu'il n'y a de précédent à La Nature morte aux homards, à cette rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur la table de dissection du paysage, comme il n'y a d'autre précédent que Lautréamont à Godard. Et je ne sais plus ce qui est le désordre, ce qui est l'ordre. Peut être que la folie de Pierrot, c'est qu'il est là à mettre dans le désordre de notre temps l'ordre stupéfiant de la passion. Peut-être. L'ordre désespéré de la passion (le désespoir, il est dans Pierrot dès le départ, le désespoir de ce mariage qu'il a fait, et la passion, le lyrisme, c'est la seule chance encore d'y échapper). L'année où Eugène Delacroix brusquement, part pour le Maroc traversant la France par la neige et une gelée de chien... une bourrasque de vent et de pluie, 1832, il n'y avait pu avoir de Salon au Louvre à cause du choléra à Paris. Mais en mai, une exposition de bienfaisance remplace le Salon, où cinq toiles de petit format prêtées par un ami représentent l'absent. Trois d'entre elles semblent avoir été faites coup sur coup, et probablement en 1826 - 1827 : l'Etude de femme couchée (ou Femme aux bas blancs) qui est au Louvre, la Jeune femme caressant un perroquet qui est au Musée de Lyon et Le Duc de Bourgogne montrant le corps de sa maîtresse au Duc d'Orléans, qui est je ne sais où. C'est dans le plein temps de sa liaison avec Mme Dalton, mais il est impossible de savoir qui sont au vrai les femmes nues de ces trois tableaux, si c'est la même. Sans doute, la Jeune femme au perroquet a-t-elle les paupières lourdes qu'on voit à la Dormeuse qui est, paraît-il, Mme Dalton. Mais ni l'une ni l'autre ne ressemblent au portrait de cette dame par Bonington. Dans le Journal d'Eugène, il passe beaucoup de jeunes femmes qui viennent poser, et à propos desquelles il inscrit dans son carnet une très particulière arithmétique. Quoi qu'il en soit, on tient Le Duc de B, etc.., pour la suite de ces deux études, et personne ne doute qu'il y ait coïncidence de strip-tease entre le tableau et la vie, Eugène pouvant bien être le Duc de Bourgogne et son ami Robert Soulier, le Duc d'Orleans. On sait comment Mme DALTON passa de l'un à l'autre. Mais la perversité du peintre n'est pas ici en question : dans Pierrot le fou c'est Belmondo qui joue avec un perroquet. Je ne dis tout ceci que pour montrer comment si je le voulais, moi aussi, je pourrais m'adonner au délire d'interprétation. Et d'ailleurs, n'est-ce pas là réponse à la question d'où j'étais parti ? L'art, c'est le délire d'interprétation de la vie. Si je voulais aussi, j'aborderais J. L. G. par le rivage des peintres pour chercher origine à l'une des caractéristiques de son art dont on lui fait le plus reproche. La citation, comme disent les critiques, les collages comme j'ai proposé que cela s'appelle, et il m'a semblé voir, dans des interviews, que Godard avait repris ce terme. Les peintres ont les premiers usés du collage au sens où nous l'entendons, lui et moi, dès avant 1910 et leur emploi systématique par Braque et Picasso : il y a, par exemple, Watteau dont L'enseigne de Gersaint est un immense collage, où tous les tableaux au mur de la boutique et le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaut qu'on met en caisse sont cités comme on se plaît à dire. Chez Delacroix, il suffit d'un tableau de 1824, Milton et ses filles, pour trouver "la citation" en tant que procédé d'expression. Il y avait quelque provocation à prendre pour sujet de peinture un homme qui ne voit point afin de nous montrer sa pensée : l'aveugle pâle est assis dans un fauteuil appuyant sa main sur un tapis de table brodé, dont ses doigts palpent les couleurs devant un pot de fleurs qui lui échappe. Mais au-dessous de ses deux filles assises sur des sièges bas, l'une prenant la dictée du Paradise lost, la seconde tenant un instrument de musique qui s'est tu, il y a une toile non encadrée au mur où l'on voit Adam et Eve fuyant le paradis perdu devant le geste de l'Ange qui les chasse sans verd, nus et honteux. C'est un collage destiné à nous apprendre l'invisible, la pensée de l'homme aux yeux vides. Le procédé ne s'est pas perdu depuis. Vous connaissez ce tableau de Seurat, Les Poseuses, où dans l'atelier du peintre trois femmes déshabillées, l'une à droite en train d'enlever des bas noirs, se trouvent à côté du grand tableau de La Grande Jatte, "cité" fort à propos pour que ceci soit autre chose que ce que nous appelons un strip-tease. Et Courbet, quand il fait collage de Baudelaire dans un coin de son Atelier, hein ? De même, dans Pierrot, Godard avant d'envoyer la lettre l'affranchit d'un Raymond Devos : comme il avait fait du philosophe dans Vivre sa vie, Brice Parain. Ce ne sont pas là des personnages de roman, ce sont des pancartes, pour apprendre comment Adam et Eve furent chassés du paradis terrestre. Au reste, s'il y a dans ce domaine une différence entre Pierrot et les autres films de Godard, c'est dans ce qu'on ne manquera pas de considérer ici comme une surenchère. Voilà plusieurs années que ce procédé est reproché à l'auteur du Mépris et du Petit soldat comme une manie dont on attend qu'il se débarrasse. Les critiques espèrent l'en décourager et sont tout près d'applaudir un Godard qui simplement cesserait d'être Godard, et ferait des films comme tout le monde. Ils n'y réussissent pas très bien à en juger par ce film-ci. Si quelqu'un devait se décourager, c'est eux. L'accroissement du système des collages dans Pierrot le fou est tel qu'il y a des parties entières (des chapitres, comme dit Godard), qui ne sont que collages. Ainsi toute la réception mondaine du début. Eh bien, non. Ils continuent, ils ont reconnu (parce que Belmondo tient l'Elie Faure de poche en main) que le texte par quoi commence toute l'histoire, sur Velasquez, est d'Elie Faure. Ils n'ont pas très bien compris pourquoi, plus tard, Pierrot lit la récente réimpression des Pieds Nickelés. Dans une histoire où Belmondo brandit un livre de la Série Noire pour dire voilà ce que c'est qu'un roman ! Moi, je me rigole, messieurs : quand j'étais enfant on ne me disait rien si on me trouvait à lire Pierre Louys ou Charles-Henry Hirsch, mais ma mère m'interdisait les Pieds Nickelés. Qu'est-ce qu'elle m'aurait passé, si elle m'avait pincé avec l'Epatant, où ça paraissait ! Je ne sais pas de quoi ça a l'air pour les jeunes blousons noirs, nos cadets, mais, pour les gens de ma génération qui n'ont pas encore la mémoire tout à fait cartilagineuse la ressemblance entre les Pieds Nickelés et les types de "l'organisation" dans le jeu compliqué de laquelle est tombé Pierrot saute aux yeux : si bien que toute cette affaire, quand Belmondo lit les Pieds Nickelés, prend un sens légèrement plus complexe qu'il ne semble à première vue. L'essentiel n'est pas là : mais qu'il faut bien au bout du compte se faire à l'idée que les collages ne sont pas des illustrations du film, qu'ils sont le film même. Qu'ils sont la matière même de la peinture, qu'elle n'existerait pas en dehors d'eux. Aussi tous ceux qui persistent à prendre la chose pour un truc feront-ils mieux à l'avenir de changer de disque. Vous pouvez détester Godard, mais vous ne pouvez pas lui demander de pratiquer un autre art que le sien, la flûte ou l'aquarelle. Il faut bien voir que Pierrot qui ne s'appelle pas Pierrot, et qui hurle à Marianne : Je m'appelle Ferdinand ! se trouve juste à côté d'un Picasso qui montre le fils de l'artiste (Paulo enfant) habillé en pierrot. Et en général, la multiplication des Picasso aux murs ne tient pas à l'envie que J.L.G. pourrait avoir de se faire prendre pour un connaisseur, quand on vend des Picasso aux Galeries Lafayette. L'un des premiers portraits de Jacqueline, de profil, est là pour, un peu plus tard, être montré la tête en bas parce que dans le monde et la cervelle de Pierrot tout est upside down. Sans parler de la ressemblance des cheveux peints, et des longues douces mèches d'Anna Karina. Et la hantise de Renoir (Marianne s'appelle Marianne Renoir). Et les collages de publicité (il y a eu la civilisation grecque, la civilisation romaine, maintenant nous avons la civilisation du cul...), produits de beauté, sous-vêtements. Ce qu'on lui reproche surtout, à Godard, ce sont les collages parlés : tant pis pour qui n'a pas senti dans Alphaville (qui n'est pas le film que je préfère de cet auteur) l'humour de Pascal cité de la bouche d'Eddie Constantine devant le robot en train de l'interroger. On lui reproche, au passage, de citer Céline. Ici Guignol's band : s'il me fallait parler de Céline on n'en finirait plus. Je préfère Pascal, sans doute, et je ne peux pas oublier ce qu'est devenu l'auteur du Voyage au bout de la nuit, certes. N'empêche que Le voyage, quand il a paru, c'était un fichument beau livre et que les générations ultérieures s'y perdent, nous considèrent comme injustes, stupides, partisans. Et nous sommes tout çà. Ce sont les malentendus des pères et des fils. Vous ne les dénouerez pas par des commandements : " Mon jeune Godard, il vous est interdit de citer Céline !". Alors, il le cite, cette idée. Pour ma part, je suis très fier d'être cité (collé) par l'auteur de Pierrot avec une constance qui n'est pas moins remarquable que celle qu'il apporte à vous flanquer Céline au nez. Pas moins remarquable, mais beaucoup moins remarquée par MM les critiques, ou parce qu'ils ne m'ont pas lu, ou parce que ça les agace autant qu'avec Céline, mais n'ont pas avec moi les arguments que Céline leur donne, alors il ne reste que l'irritation, et le passé sous silence, l'irritation pire d'être muette. Dans Pierrot le fou un grand bout de La Mise à mort..., bien deux paragraphes, je ne connais pas mes textes par coeur, mais je les reconnais, moi, au passage... dans la bouche de Belmondo m'apprend une fois de plus cet espèce d'accord secret qu'il y a entre ce jeune homme et moi sur les choses essentielles : l'expression toute faite qu'il la trouve chez moi, ou ailleurs, là où j'ai mes rêves (la couverture de l'Ame au début de La femme mariée, Admirables fables de Maïakovski, traduit par Elsa, dans Les carabiniers, sur la lèvre de la partisane qu'on va fusiller). Quand Baudelaire eut dans Les phares collé un Delacroix, Lac de sang hanté des mauvais anges..., le vieux Delacroix lui écrivit : Mille remerciements de votre bonne opinion : je vous en dois beaucoup pour les Fleurs du Mal : je vous en ai déjà parlé en l'air, mais cela mérite toute autre chose... Quand, au Salon de 1859, la critique exécute Delacroix c'est Baudelaire qui répond pour lui, et le peintre écrit au poète : Ayant eu le bonheur de vous plaire, je me console de leurs réprimandes. Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts. Vous me faîtes rougir tout en me plaisant beaucoup : nous sommes faits comme cela... Je ne sais pas trop pourquoi je cite, je colle cela dans cet article : tout est à la renverse, sauf que oui, dans cette petite salle confidentielle, noire, où il n'y avait qu'Elsa, quand j'ai entendu ces mots connus, pas dès le premier reconnus, j'ai rougi dans l'ombre. Mais ce n'est pas moi qui ressemble à Delacroix. C'est l'autre. Cet enfant de génie. Voyez-vous, tout recommence. Ce qui est nouveau, ce qui est grand, ce qui est sublime attire toujours l'insulte, le mépris, l'outrage. Cela est plus intolérable pour le vieillard. A soixante et un ans, Delacroix a connu l'affront, le pire de ceux qui distribuent la gloire. Quel âge a-t-il, Godard ? Et même si la partie était perdue, la partie est gagnée, il peut m'en croire. Comme j'écrivais cet article, il m'est arrivé un livre d'un inconnu. Il s'appelle Georges Fouchard, et son roman, De seigle et d'étoiles ce qui est un titre singulier. Je l'ai lu d'une lampée. Je ne sais pas s'il est objectivement un beau livre. Il m'a touché, d'une façon bizarre qui avait trait à Delacroix. On sait de celui-ci, que tous les ans, avec deux amis (J.B. Pierret et Felix Guillemardet), depuis 1818, il fêtait, à tour de rôle chez l'un chez l'autre, la Saint-Sylvestre. On imagine ce que ces réunions périodiques, dont il nous est resté des dessins de Delacroix, supposaient d'espoirs, de projets, de confidences, de discussions... Guillemardet meurt en 1840, Pierret en 1854. Ni l'un ni l'autre ne sont devenus grand'chose. Delacroix finira seul cette vie, sans ses amis de jeunesse. Or, dans De seigle et d'étoiles, le roman tourne autour de trois amis, Bouju, Gerlier et Frédéric, qui ont formé une sorte de groupe à trois, Mach 3, qu'ils l'appellent. Le roman, c'est ce que cela devient et ce que cela ne devient pas. Tout recommence, je vous dis. L'anecdote varie, et c'est tout. Votre jeunesse, jeunes gens, c'est toujours la mienne. Et Bouju écrira, presque pour finir, cette lettre, ce désespoir de lettre, parce qu'après tout Mach 3 c'est simplement trois pauvres types inadaptés. Drôle ce chiffre trois, pour Delacroix, pour moi. Et Bouju écrit tout de même, sans doute pour optimiser, comme il dit... quel âge a-t-il, Bouju, à cette minute là ? Et Fouchard lui, il a trente-cinq ans quand paraît son premier roman, comme dit le prière d'insérer. J'insère. Mais Bouju qui s'intitule le braillard de l'Anti-Système dit encore : Vingt, vingt-cinq bouquins, nous écrirons si c'est nécessaire pour réveiller ce petit déclic qui marque des soubresauts dans les foules de tous les pays. Si vous ne comprenez pas, allez donc faire de la bicyclette, ça vous fera les mollets... Quel rapport, ceci qui vient après une sorte de bilan de la destinée d'un Rimbaud, quel rapport cela a-t-il avec Pierrot le fou, avec Godard ? Combien y-a-t-il déjà de films de Godard ? Nous sommes tous des Pierrot le fou, d'une façon ou de l'autre, des Pierrot qui se sont mis sur la voie ferrée, attendant le train qui va les écraser puis qui sont partis à la dernière seconde, qui ont continué à vivre. Quelles que soient les péripéties de notre existence, que cela se ressemble ou non, Pierrot se fera sauter, lui, mais à la dernière seconde il ne voulait plus. Voyez-vous tout cela que je dis paraît de bric et de broc : et ce roman qui s'amène là-dedans comme une fleur... Si j'en avais le temps, je vous expliquerais. Je n'en ai pas le temps. Ni le goût d'optimiser. Mais pourtant, peut-être, pourrais-je encore vous dire que tant pis pour ce qu'on était et ce qu'on est devenu, seulement le temps passe, un jour on rencontre un Godard, une autre fois un Fouchard. Pour la mauvaise rime. Et voilà que cela se ressemble, que cela se ressemble terriblement, que cela recommence, même pour rien, même pour rien. Rien n'est fini, d'autres vont refaire la même route, le millésime seul change, ce que cela se ressemble... Je voulais parler de l'art. Et je ne parle que de la vie. (Louis Aragon, Les lettres françaises, n°1096, 9-15 Septembre 1965)
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
terça-feira, 26 de outubro de 2010
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
sábado, 9 de outubro de 2010
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
terça-feira, 28 de setembro de 2010
segunda-feira, 30 de agosto de 2010
sábado, 14 de agosto de 2010
sexta-feira, 13 de agosto de 2010
Para mim, a atitude “mundana” que creio ser nefasta não é apenas “voltar-se para o mundo”, nem mesmo a secularização total que se quer sem compromissos, da turma do “honest to God”. É ainda menos a nobre preocupação pela justiça social e pelo bom emprego da tecnologia a serviço das verdadeiras necessidades do homem em sua indigência e seu desespero. O que quero dizer por “mundanidade” é o envolvimento na absurda e maciça mitologia da cultura tecnológica e em todas as invenções obsessivas de sua mente vazia. Um dos sintomas disso é precisamente a angustiada preocupação de manter-se em dia com a fictícia, sempre variável e complexa ortodoxia em matéria de gosto, política, culto, credo, teologia e que sei mais — um cultivar o jeito de redefinir, dia a dia, a própria identidade em harmonia com a autodefinição da sociedade. “Mundanidade”, a meu ver, é típico dessa espécie de servidão em relação ao cuidado com as aparências e a ilusão, essa agitação em torno de pensar os pensamentos certos e usar os chapéus corretos; essa vulgar e vergonhosa preocupação, não com a verdade, mas apenas com aquilo que está em voga. A meu ver, a preocupação dos cristãos em manterem-se na moda por medo de “perderem o mundo” é apenas mais uma lamentável admissão de que já o perderam.
Conjectures of a Guilty Bystander, de Thomas Merton
(Doubleday, New York), 1966. p. 284
No Brasil: Reflexões de um espectador culpado, (Editora Vozes, Petrópolis), 1970. p. 329
quinta-feira, 22 de julho de 2010
segunda-feira, 12 de julho de 2010
quinta-feira, 8 de julho de 2010
« No começo, pensei que era possível a um diretor, imbuído de uma sinceridade juvenil, transmitir isso diretamente. Minhas buscas eram antes de tudo de ordem plástica. O cenário, as oposições dos valores, a harmonia dos movimentos dos atores, achava que isso permitiria a criação de um pequeno universo suficientemente interessante. Logo percebi que dessa maneira só poderia produzir obras bastante frias. As grandes artes, como a filosofia, pintura, música, arquitetura ou poesia, permitem ao autor uma comunicação direta com o público. O autor de filmes dramáticos, como o romancista, deve utilizar a intermediação dos personagens. Só se concedendo a esses personagens uma personalidade autêntica é que se pode fazer com que esses filmes se tornem uma forma de expressão de nossa pobre humanidade; só assim o autor pode tentar, através da descrição sincera dessas almas, deixar transparecer um pouco de seu próprio sentimento. »
Jean Renoir, Como Animo Meus Personagens, Pour Vous, n° 242, 6.7.1933. Republicado em Escritos Sobre Cinema, Pierre Belfond, 1974
terça-feira, 6 de julho de 2010
sábado, 3 de julho de 2010
The complexity and ambiguity of narrative and psychology alike in Rohmer’s work embodies, last of all, a sort of ideal classicism, the most capable of depicting the modern world. Critics, moreover, have always got a little lost here. Is Rohmer classical or modern? Serge Daney, who was far from being the most incompetent of his commentators, wrote in 1982, when A Good Marriage was released: “As a classical filmmaker, Rohmer comes up against the major problem of classicism: he goes faster and faster [. . . ] but the faster he goes, the less he goes anywhere.” And two years later he wrote about Full Moon in Paris that Rohmer “practices a sort of perverse Brechtism,” and that “the modern auteur is jealous of his spectator. His art, in the final analysis, consists in taking us back to the bedroom door. This may be called ‘alienation.’” In reality, Rohmer was probably the only classical French filmmaker to film modernity so accurately and so fully. As a good classical artist, Rohmer thought that life is difficult but simple, and he systematically filmed modern characters who think that life is easy but complicated. So it was in a perverse way that Rohmer would spend the 1980s depicting, in his “Comedies and Proverbs,” young people going astray in phoney problems, and lying to themselves, when their quests are usually objectless and lost from the outset. Where Rohmer is not just a classical artist resides in the fact that, by being the only artist to film the modern world from such a lofty angle, he literally invents, live, characters, gestures, décors, and novel situations which are, by definition, modern. Rohmer’s enemy is not, as people have here and there claimed, modernity, but imprecision. He is a bit like Hawks, his favorite filmmaker, who, at the end of one of the most classic Hollywood films there is, announced in Man’s Favorite Sport? Godard’s abstract ballets of the 1980s, and the soap opera in Red Line 7000, simply filming an irrevocably altered world with his own means. Julien Mahon, Lessons from Éric Rohmer, MAY, Quarterly Journal, n°3 (03 / 2010)
domingo, 27 de junho de 2010
domingo, 20 de junho de 2010
DANEY Serge
Un frêle fantôme hante tout le festival, celui du premier film du jeune cinéaste (peut-être) génial. La «révélation», comme on dit dans la presse, l'«espoir», l'assurance que le cinéma continue, produit ses Rimbaud et ses «poètes de sept ans» contre vents et marées, qu'il repart à zéro, qu'il ne meurt pas. Mais en même temps, parce qu'on a trop vanté de talents qui n'ont pas tenu leurs promesses, parce qu'on a appelé «jeunes cinéastes» des débutants tardifs qui n'étaient plus des adolescents depuis longtemps, parce que les producteurs en mal de relève-chair fraîche ont brûlé trop vite de jeunes talents à coups de budgets trop lourds, cette hantise n'ose plus trop se dire. On se contente de savoir gré aux jeunes cinéastes d'aujourd'hui de porter avec eux la sensibilité des années 80, de «ressembler» à leur époque, alors qu'ils n'y ont, évidemment, aucun mérite. Ils arrivent maintenant, très maniérés, souvent nostalgiques, agressifs par force, ignares et très cinéphiles. Ils savent bien qu'il leur est difficile de faire aussi facilement scandale que leurs aînés et qu'il y a une révolte, quelque part, dont on les a privés. Mais ils arrivent, nécessairement.
Hier, nous avons vu Boy meets girl, premier long métrage de Léos Carax. C'est un vrai premier film et c'est (parions sur lui) un vrai auteur.
Mais comme on l'est à son âge, c'est-à-dire à 23 ans. Le film est évidemment inégal, bancal et troué d'impasses, mais il respire le cinéma et il date de 1984. Les comédiens ont l'âge de leur metteur en scène, le héros, Alex, ressemble à Carax comme à un frère, et ils ne parlent que de ce qui les encercle: le mal de vivre, l'envie d'en avoir déjà fini, d'avoir une oeuvre derrière soi, le goût et le dégoût du monde, la pudeur, les idées noires et un ego à toute épreuve. Par ailleurs, Carax a, chose rare, un don pour la poésie.
Un film comme Boy meets girl ne gagne rien a être raconté. Pas parce qu'il y aurait un mystère à préserver dans l'histoire qui n'est jamais que celle bressonienne d'un jeune garçon, la dernière nuit avant son départ pour le service militaire, entre une fille qui l'a quitté et une autre qu'il rencontre, déjà «entre le chagrin et le néant». C'est que le mystère est dans la sûreté de la mise en scène lorsqu'elle donne ce sentiment intenable de précarité, dans la beauté des soliloques à la voix blanche, sans filet.
Il y a deux copains discutant sur les berges de la Seine, la nuit, et l'un se précipite sur l'autre, il y a des confessions sexuelles, très osées et très douces, en voix off, un flipper ouvert et qui clignote quand même, un enfant qui commence un monologue ravagé dans le métro, un homme muet qui reproche aux jeunes «de ne pas parler», des enfants oubliés qui pleurent dans une pièce un soir de réception, des disques volés par amour, une chambre de bonne éclairée par la lumière d'un frigo ouvert, l'orgueil des peines d'amour perdues et une absence quasi totale d'adultes.
Un jeune auteur (Carax?), c'est quelqu'un qui sait qu'il a déjà vu beaucoup de films, vécu peu de choses (mais difficilement, déjà) et qu'il n'y a pas de temps à perdre pour commencer à les dire. Parce qu'on fait le cinéma avec ce qu'on a. Autobiographie et programme exalté de vie à venir (fulgurante), puis moments d'aphasie où l'hommage au cinéma muet n'est pas une coquetterie cinéphile mais un mauvais moment à passer. Horreur d'errer dans un monde «déjà vu» mais «pas encore vécu». Jeune vieillard qui ne pourra que rajeunir.
Il y a quelque chose d'aujourd'hui dans le regard buté d'Alex et de Mireille, adolescents même pas paumés, tout juste «ajoutés» au monde qui les entoure . Et il y a aussi quelque chose d'hier dans leur façon de vivre leur vie comme un destin, mais au futur antérieur, comme dans un roman du XIXe siècle. A même le mur blafard de sa chambre, Alex a dessiné, grossière, une carte de Paris sur laquelle il porte soigneusement les lieux et les dates de tout ce qui fut pour lui «une première fois». Belle image pour un premier film: naissance, premier baiser, première tentative de meurtre, etc.
Il y a aussi quelque chose d'aujourd'hui dans cette manière de Carax de recommencer le cinéma autobiographique de la nouvelle vague (de Godard à Garrel, mais aussi de Skolimovski à Bertolucci), plus dans le Paris lumineux libéré des studios que nous découvrait Coutard mais dans un Paris nocturne, obscur, contrasté, entre chien et loup, strié de néons et de faux jours, le Paris de tous les cinéastes de sa génération.
Qui est Léos Carax? Un double d'Alex, mais encore? Léos non plus n'est pas grand, il porte des vestes immenses qui le font paraître encore plus jeune, il ne parle pas beaucoup, il a fait un court métrage (Strangulation blues), il ne vit que du cinéma. Il ressemble aussi au Léaud qui volait des photos de stars dans les 400 coups. C'est lui, souvent, qui vient demander à une vendeuse d'une grande librairie de cinéma parisienne si elle n'a pas «des trucs nouveaux» sur Godard. Des affiches ou des photos. Car, le lecteur l'aura compris, Godard est un dieu pour Carax.